News

Une Libanaise à Florence
Imane Bitar Dami, est une ancienne élève du collège Protestant Français de Beyrouth et membre de l'association des anciens élèves de l'établissement. La "matheuse" du collège protestant n'a jamais arrêté de jongler avec les chiffres et les figures géométriques, à travers les pays et les générations.

Imane, vous vivez à Florence mais vous venez de Beyrouth ?
Je suis née à Beyrouth, dans une famille entièrement dévouée à l'éducation française. Ma mère était elle-même enseignante et mon père, diplomate, avait fait toutes ses études en France. Cela a toujours été une évidence dans laquelle j'ai grandi. C'est comme cela que je concevais l'école et tout naturellement, j'ai continué la tradition, en envoyant mes filles à l'école française de Florence. Car venue faire un stage d'architecture en Italie pour acquérir le savoir-faire pour la reconstruction de centre-ville de Beyrouth, j'y ai rencontré mon futur mari italien « grâce » à un accident de voiture où il m'a secourue. Et heureusement, il parlait français…
Mais revenons à mon enfance à Beyrouth. Je suis allée au Collège Protestant Français, établissement conventionné AEFE, toute ma scolarité de la petite section de maternelle jusqu'au bac. C'était le choix de mon père pour moi, ma sœur, mon frère et en plus, c'était tout près de chez nous. Mes cousins, eux, allaient à la mission laïque. A la maison, on parlait « ce qui venait à la bouche », le français, l'arabe, l'anglais. Ce que les linguistes appellent le code switching. Et dès qu'on était dans un milieu unilingue, on se forçait pour utiliser la même langue dans la même phrase. Mes filles suivent cette tradition familiale, car en plus de toutes ces langues, elles parlent italien mais aussi l'allemand car la mère de mon mari vient d'une région frontalière où ils parlent un dialecte germanique.
Je garde de très bons souvenirs de mon école, alors qu'il y a presque 40 ans presque que je l'ai quittée. Nous sommes encore reliés entre camarades connus là-bas. Deux exemples, lorsque la mère de l'une d'entre nous est morte, c'était une Arménienne, nous sommes tous allés à l'enterrement, pour soutenir les enfants de la famille. C'était très fort. Et quand j'ai eu besoin de renseignements pour inscrire mes filles à l'école française, mon ancienne prof d'Histoire-Géo du Collège m'a préparé tout un dossier. Dans cette école, on nous a appris l'autodiscipline et à raisonner pour faire nos choix. C'est une richesse extraordinaire d'avoir plusieurs cultures dans un même contexte éducatif, cela permet de voir les choses de différentes façons.
Vous êtes très impliquée dans la vie de l'école française de Florence ?
Les maths, c'est mon truc. Chaque matin, en me levant, je fais un petit exercice de maths, c'est amusant. C'est comme cela que j'ai commencé à animer des ateliers de jeux mathématiques au lycée Victor Hugo, de façon à la fois ludique et philosophique. Je fais des petits jeux aux enfants du primaire géométrie avec origami ou des opérations avec les tangrams (puzzles) chinois ou j'invente des jeux avec des roues. Cela passionne tellement mes petits que certains ne veulent même plus sortir en récréation, ni rentrer chez eux. Finalement, j'ai passé toute une vie au lycée. Je « redouble » sans cesse.
J'ai eu des jumelles, qui ont toujours été d'excellentes élèves. Elles poursuivent aujourd'hui leurs études à Paris et quand la nostalgie les rattrape, elles vont écumer les restaurants libanais. Dans leur école, il y avait de nombreuses nationalités et une grande solidarité. Comme ce sont souvent des familles nucléaires, sans ascendants présents, on s'est beaucoup entraidé entre mamans. Car les horaires de l'école française ne correspondent pas à la vie italienne, comme par exemple aller chez le pédiatre. Alors on s'aide les unes les autres. Des soirs, j'avais 4 ou 5 petites dans la baignoire. Le plus beau souvenir fut le mois de bachotage avant le bac de mes jumelles. Une quinzaine d'élèves et plusieurs professeurs avaient élu domicile dans ma grande maison. Mon mari faisait les courses, moi je faisais la cuisine. Et plein de cours particuliers. On a eu un taux de réussite à 100 %. A la suite de cela, Mme Martino, la proviseure du lycée Victor Hugo (l 'école française MLF de Florence) en juin 2018 m'a remis un diplôme, comme vous pouvez me voir en rouge sur la photo, avec le chapeau de lauréate.. Quand je vous dis que je ne quitterai jamais l'école française, c'est mon milieu naturel, où que je sois dans le monde.
Comment avez-vous vécu l'épidémie de COVID-19 en Italie, ce pays premier touché en Europe ?
A Florence, cela a été moins grave que dans d'autres villes. Les Florentins ont été disciplinés. Rien n'a manqué, même si on s'est confiné le plus possible pour faire le moins de dégâts possible. Mais il n'y a pas eu une vraie gestion du gouvernement. Personne ne savait. Le message passait mal. On ne nous a pas assez averti, on n'a pas assez pris de précautions au début. On n'a pas tenu compte des erreurs que des personnes peu informées pouvaient faire, comme celle tragi-comique, de faire sécher des masques à usage unique sous la pluie sur un balcon sous lequel passaient des personnes …Cela a été assez catastrophique et cela m'a beaucoup énervé, car il s'agit de vies humaines. En Lombardie, il y a eu un double discours, à la fois dirigiste et laxiste. Même dans notre famille, il y a eu des aberrations : une cousine a maintenu une réunion de famille à Rome. Nous avons décidé de ne pas y aller et après, on a appris qu'ils sont tous allés au restaurant, sans protections. D'autres Italiens n'ont pas cessé de se déplacer, en particulier vers le Sud. Heureusement qu'il y a eu beaucoup de solidarité populaire. Avec les anciens de l'école, nous avons monté un groupe pour aider.
Au Liban, ils ont eu beaucoup moins de problèmes que nous. Ils ont tout fermé dès le début, avec le premier cas le 20 février, car ils avaient vu ce qui se passait en Iran. Et là, on ne jouait plus. On a fait une liste des pays d'où l'on ne pouvait pas venir. Cela tient aussi à la mentalité libanaise de prendre les choses en main tout de suite. Cela est peut-être dû au fait que nous sommes habitués aux situations d'urgence. Dès l'apparition d'un problème, on l'aborde et on s'y confronte. Maintenant, il y a une crise économique aigüe qui se profile. Il y aura peut-être de l'argent du FMI, mais cela partira comme d'habitude dans la corruption si on ne fait pas conjointement les réformes. Malgré un gouvernement imposé durant le coronavirus, les gens retournent dans la rue. Mon pays est un pays plein de charme, mais qui a du mal à vivre, à survivre même.
Le Liban reste cher à votre cœur ?
Je retourne régulièrement au Liban, tous les ans. J'y étais pour les cérémonies du centenaire. Ma sœur, enseigne au Collège Protestant Français. Mon pays me manque vraiment. Ce n'est que quand on se retrouve à l'étranger qu'on se rend compte combien on y est attaché. Mais ce pays est toujours en crise, tant il doit défendre sa souveraineté et son indépendance. Nous avons toujours été occupés : depuis l'antiquité, et les occupants ont toujours joué une fraction contre une autre. Il y a 18 communautés différentes : Chrétiens (différents), Musulmans (différents), Druses, Juifs, … et on les retrouve toutes dans ma propre famille, représentative donc du Liban des villes et non celle des villages Aux funérailles de ma mère, il y a eu des prières dans tous les rites, même si moi, je ne suis pas très religieuse. Sans compter les cousins des Etats-Unis, du Canada, d'Allemagne... Car la diaspora libanaise est très importante à travers le monde. Je crois beaucoup à l'action d'associations comme l'ALFM pour essayer de rapprocher le monde et de fait=re en sorte qu'il y ait moins de racisme et d'incompréhension entre les différents mondes.
Interview réalisée par Effy Tselikas, journaliste, membre de l'Union-ALFM
Lire aussi : Un jeune libanais à Paris
 1
1













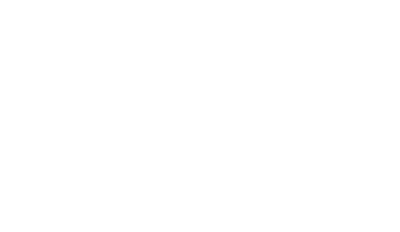
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.