News

« Le lycée français de New York, c'est ma patrie » Harold Hyman, journaliste
Harold Hyman, journaliste franco-américain et chroniqueur à CNews (Face à l'info, tous les dimanches soir), a effectué toute sa scolarité au lycée français de New York. Il nous raconte son bonheur d'ancien élève et l'influence que cela a eu sur son regard professionnel de journaliste, en particulier pour l'actualité sanitaire du COVID-19 et les manifestations antiracistes de ces derniers jours.

Vous avez fait votre scolarité dans un lycée français ?
J'ai fait toute mes études au lycée français de New York, de la maternelle à la Terminale. Le lycée, c'est mon milieu naturel, ma patrie. J'y suis allé parce que ma mère est française. Elle a rencontré mon père à Paris où il faisait ses études, ils se sont mariés et en 1957 et ont décidé d'aller vivre aux Etats Unis. Ma mère a donc vécu là-bas sans chercher à obtenir sa naturalisation et revenait en France tous les ans. J'avais ainsi un pied dans chaque pays et dans chaque culture. Petit, je parlais anglais avec mon père et avec les autres enfants dans mon quartier. Quand à 6 ans, j'ai intégré l'école, je ne parlais pas vraiment français, je comprenais plus ou moins ce qui se disait. Je n'oublierai jamais le jour où on est allés voir les animaux qui vivaient à Central Park et qu'on les a répertoriés en français. Moi, je n'arrivais pas à prononcer le « r » français de mon animal, l'écureuil. C'est pourtant devenu très vite la langue de ma scolarité. Mais entre les cours et la récréation, on faisait très souvent des va-et-vient dans les deux langues, sans même y réfléchir. Lorsqu'on avait une difficulté à dire un mot dans une langue, on passait à l'autre langue, dans un charabia un peu mélangé.
Au lycée français il y avait un grand mélange, avec quatre catégories d'élèves : les enfants des diplomates, les enfants des ambassadeurs de l'ONU : Mali, Sénégal, Maroc, … Puis, les enfants des cadres supérieurs des grandes entreprises françaises : Renault, Hermès… Ensuite, les enfants de Français établis à New-York, plus ou moins mélangés, parfois moitié américain - moitié français comme moi et très souvent issus du monde de la cuisine, car la gastronomie française est très présente aux USA depuis plus d'un siècle. Et enfin, les Américains excentriques que les parents envoyaient au lycée pour être différents. Mais aussi une cinquième catégorie, celle des enfants venus de pays d'anciens régimes déchus où le français était la langue des gens « classe ». C'est le cas de Roumains ou de Hongrois ou de Cambodgiens qui avaient fui le nazisme et/ou le communisme. Il y avait donc très peu de contacts avec des Américains (moins de 10% dans toute l'école, souvent des enfants d'acteurs comme la fille de Lauren Bacall par exemple). Dans cette école, on était en France : on ne jouait pas au baseball, ni au football. J'étais complétement décalé par rapport aux Américains. Je ne comprenais pas et je ne comprends d'ailleurs toujours pas leur fascination pour les jeux de ballon ; je n'ai pas eu les rituels qu'ils ont eus, eux, dans leur enfance. Quand j'ai commencé ma scolarité, n'ayant pas eu de « vie américaine », je me suis retrouvé avec d'autres enfants pas si différents de moi, des « moit-moit ». Ma réalité à moi, c'étaient des « multi-culti », des « franco-machin », des « judéo-tchèques », des africains ou des vietnamiens…, j'allais dans les familles de mes copains manger des tajines ou du manioc. Mes plus vieux et chers copains sont de ce lycée où j'ai passé douze ans avec les mêmes personnes. J'en ai trois, quatre, fidèles qui sont toujours là. Et il y en a même avec qui je suis allé en fac, à Columbia. Ce sont mes amis de toujours.
" Ma réalité à moi, c'étaient les "multi-culti", des "Franco-machin", des "judéo-Tchèques", des Africains ou des Vietnamiens... j'allais dans les familles de mes copains manger des tajines ou du manioc "
Le lycée de New York n'était pas une école bilingue, c'était une école française unilingue, issue d'une histoire française. L'avantage, c'est qu'on y a reçu le cursus français intégral : les livres venaient de France, les profs venaient de France, et tout était en français sauf les cours d'anglais bien évidement. L'intérêt n'était pas d'apprendre le français, mais d'apprendre tout en français. J'ai appris depuis d'autres langues comme l'espagnol ou l'italien, mais la différence, c'est que je n'ai pas appris les sciences ou les arts dans ces autres langues. Mes références sont françaises et j'ai parfois encore du mal avec les sources en anglais. Mon établissement n'était pas une école « multiculturelle », c'était une école qui avait une culture française classique, immuable ! Ce n'était pas la France de tous les jours, c'était une France imaginaire, idéalisée. Cela a rebuté beaucoup d'élèves et en a enchanté d'autres. Pour moi, c'est la base formelle de la culture classique française, une connaissance magistrale : « Nous les profs, nous savons. Vous les élèves, vous ne savez pas » et hiérarchique : « Voilà les bonnes connaissances et voilà les mauvaises ». Et ensuite, nous devions jongler au mieux pour générer des idées critiques originales. Cette approche pédagogique n'était pas ce qui était en vogue au Etats-Unis à l'époque et encore aujourd'hui, qui est plutôt centré sur la découverte du soi-même mythique, dans une relation d'égalité avec le professeur. Nous, le matin, quand le prof mettait un pied dans la salle, toute la classe se levait dans le silence ! Et après un « Bonjour madame », on faisait l'appel et on commençait la classe sans que personne ne se rentre ni sorte pendant le cours… L'individu n'est pas glorifié, mais n'était pas écrasé non plus ! Voilà, j'ai gardé cette mentalité. C'est pour cela que je n'aime pas les gens qui parlent sans savoir, cela m'insupporte ! C'est pour cela que je suis devenu journaliste.
Donc, vous êtes devenu journaliste ?
J'ai fait tout d'abord un an à l'Université d'Assas, mais j'ai arrêté parce que j'étais trop mauvais en économie. Puis, je suis retourné à New York, à Colombia University en section Lettres. Ça s'est très bien passé. J'ai ensuite vécu quelques temps à Paris et je suis reparti à l'Université de Montréal au Canada où j'ai fait des études d'Histoire. A peine déposé mon mémoire de maitrise à l'Université de Montréal, une semaine plus tard, je revenais à Paris et six semaines plus tard, je devenais journaliste grâce à mon bilinguisme. En presse écrite, dans un magazine anglais édité à Paris, Paris Passion. J'y étais SR (secrétaire de rédaction) et correcteur réviseur de tout. Mon travail consistait à relire tout le magazine de A à Z. Ensuite, je suis passé au Reader's Digest où j'étais fact-checker. C'était l'époque avant le Web, et on en passait alors des coups de fil… On téléphonait à l'Institut de la Poupée pour savoir si au XVIème siècle, les poupées étaient en porcelaine ou en plâtre. Les gens aujourd'hui ne savent plus ce qu'est qu'une source, tant on a accès tellement facilement aux informations sur Internet. Ensuite, je suis passé en radio avec RFI (Radio France internationale), puis Radio Classique et Courrier international. Puis BFMTV, pendant dix ans et maintenant je suis à CNews. J'ai toujours été dans l'international, avec des ouvertures sur la culture et le patrimoine.
" Je n'ai jamais pensé que l'école brimait ma liberté et m'empêchait de penser ; au contraire, j'ai l'impression que l'école m'a permis de penser, mais de manière disciplinée "
Mon regard professionnel sur le monde vient aussi de cette éducation fondamentale que j'ai reçue au lycée. Tout d'abord, j'aimais énormément l'école et même aujourd'hui, je fais des lapsus révélateurs : je dis « la maîtresse » pour la rédactrice ou « le prof » pour le directeur, ou encore « je vais en classe » quand je vais travailler sur ma chaîne. Et j'ai constamment l'impression de préparer une interrogation. Je n'ai jamais pensé que l'école brimait ma liberté et m'empêchait de penser ; au contraire, j'ai l'impression que l'école m'a permis de penser, mais de manière disciplinée. Et j'ai eu un prof d'histoire-géo qui était formidable, un Alsacien, qui m'a vraiment inspiré toute ma vie. Son cours d'histoire-géo, c'était le bonheur total ! J'avais toujours des 18, quand mes autres camarades s'ennuyaient, mais je leur disais : « Comment peux-tu t'ennuyer ? Ce prof est en train de te raconter pourquoi il y a des frontières dans ton pays, comment elles ont été construites. Ça ne te fait rien, toi ? Tu aurais pu naître de l'autre côté, ça ne te fait rien ? Et pourquoi as-tu cette religion ? Et pourquoi as-tu cette langue ? Ça, tu t'en fiches complètement ? C'est beaucoup moins intéressant que d'aller acheter un disque de Led Zeppelin ou de draguer … »
Comment avez-vous vécu la période Covid-19, dans votre vie personnelle et professionnelle ?
Personnellement, je n'ai pas souffert un seul instant de la période de confinement. Pas un seul instant ! En fait, j'ai à peine remarqué la différence ! Je pouvais et devais aller à la télévision en bicyclette. En studio, on était assis et on parlait, de préférence pas trop près les uns sur les autres. En rédaction, on utilisait masques et gel. L'environnement aussi avait changé : l'air n'a jamais été aussi propre, on entendait les oiseaux, il y avait beaucoup moins de pollution sur la Seine. Parfois j'allais même à la rédaction sans avoir vraiment besoin, en week-end, juste avec ma bicyclette, juste pour prendre des photos. Cela m'a aéré plus qu'autre chose. Il y a eu quand même des conséquences professionnelles dans mon secteur : beaucoup de journalistes d'autres services ont été envoyés en télétravail, mais pas les présentateurs et intervenants de plateau. Beaucoup de pigistes ont été affectés, n'ont pas été renouvelés, beaucoup d'émissions ont été annulées. Il y a eu une baisse, mais pas aussi grande que l'on aurait pu penser, car certains pigistes ont été appelés pour travailler sur le Covid-19 et le confinement, alors qu'ils n'auraient peut-être pas eu cet appel-là en temps normal. Quant à la maladie, nous avons eu plusieurs cas à la chaine, 4 ou 5 cas, qui l'ont vraiment eue ! Mais la majorité est passée au travers sans la subir. On a beaucoup travaillé par Zoom ou Skype. Le plus difficile a été l'accès pour les reportages aux urgences et aux salles de réanimation. On a inventé beaucoup d'alternatives pour gérer la situation, mais cela ne remplacera pas la rédaction, faite d'échanges informels avec les autres, souvent autour de la machine à café.
" On a inventé beaucoup d'alternatives pour gérer la situation, mais cela ne remplacera pas la rédaction, faite d'échanges informels avec les autres, souvent autour de la machine à café "
Durant cette période, nous étions submergés par un flux important d'informations souvent contradictoires. On nous donné en exemple la Suède (je suivais le sujet) qui n'a pas confiné. Et maintenant, on voit qu'il y a plus de personnes qui meurent en Suède qu'en France, aussi bien en nombre qu'en proportion. Pour la politique sanitaire de Taïwan, je suis allé voir leur bureau diplomatique à Paris. J'ai passé une heure et demie avec eux, en plus d'avoir lu tout ce que je pouvais lire. Concrètement, je me basais sur le site américain JHU (Johns Hopkins University) qui rassemble tous les chiffres officiels, malgré la comptabilité différente dans chaque pays. Pour les contrées dont je parle la langue (Italien, espagnol portugais), j'allais sur le site de leur ministère de la santé. Certes, il y a des pays où on a des doutes sur les chiffres comme la Chine, la Corée du Nord, le Turkménistan. Ce qui a été difficile pour vraiment informer, c'était la confusion parmi les scientifiques qui ne maitrisaient pas toutes les données : peut-on être réinfecté après, combien de salive de l'autre suffit à vous contaminer, combien de temps peut-on être asymptomatique ? Ce qu'ils savaient, c'est qu'il n'y avait pas assez de masques, sans savoir à quel point le masque était utile et à quel degré. Donc, on a fait des erreurs : il ne fallait pas faire les municipales, il fallait dire aux gens de mettre n'importe quoi sur leur visage (une chaussette, une écharpe, un bandana, un torchon de cuisine, …). Cela valait mieux que rien. Personne n'a pris la responsabilité de le dire, en attendant le modèle homologué par les normes française et européenne. Devant cette incertitude, la presse est alors devenue une plateforme pour pouvoir débattre de toutes ces hypothèses !
L'autre difficulté a été la part prise dans l'information par les réseaux sociaux, qui accusent les médias classiques d'être inféodés à la puissance de l'argent ou à la puissance de l'état. Je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. Ces gens-là se proclament journalistes, alors qu'ils ne le sont pas. C'est un métier, c'est notre métier, on n'en a pas d'autre ; je ne suis pas danseur ni chanteur professionnel et tous les ans, je dois le déclarer à la Commission des journalistes ! Les médias classiques organisent aussi des débats, des tables rondes, des chroniques, des interviews spéciales, des reportages. La hiérarchisation et l'angle des informations est importante et le doute aussi. Moi, je suis journaliste. J'ai le même attachement avec mon journal, qu'a le médecin avec son hôpital. Ce n'est pas moi qui dirige l'hôpital. A cet instant, il se trouve que j'aime beaucoup mon média-hôpital. Il y en a eu certains médias que je n'ai pas aimés, d'autres que j'ai aimés au début mais pas à la fin, à la fin mais pas au début, … C'est la trajectoire de tout journaliste. Mais mon plus, c'est d'avoir la capacité de décrypter comment font les autres pays dans le monde et de pouvoir comparer. C'est ma formation au lycée qui fait que je suis une des personnes les mieux placées pour le faire dans le métier.
Votre regard sur ce qui se passe ces jours-ci des deux côtés de l'Atlantique ?

Ce qui se passe aux Etats-Unis vient de très loin, mais s'est exacerbé avec l'épidémie et le confinement. Ce sont les Noirs qui ont le plus souffert du virus. On les a accusés d'être obèses, mais c'est surtout qu'ils ont des métiers avec beaucoup de contacts et sans couverture médicale pour beaucoup. Et le confinement leur a fait perdre leur boulot (manutention, coursiers, restaurants, …). Surtout que là-bas, il n'y a pas eu d'aides de chômage comme en Europe. Cette souffrance sociale a fait ressortir toutes les facettes cachées. De leur côté, les Blancs ont honte, ils ne peuvent plus s'identifier à cette police borderline. L'image d'une police mythique s'est dissipée remplacée par l'image d'un gang soutenu par les tribunaux. Aujourd'hui, les flics sont mal payés, mal formés et font des boulots à côté pour survivre. Les autorités politiques leur en demande trop, exige du chiffre, ce qui les poussent à la bavure. Le cocasse dans cette histoire, c'est que le policier incriminé était videur dans la même entreprise que George Floyd, l'homme qu'il a tué. Tout le monde connait cette situation toxique de discrimination raciale. Tous mes copains blancs qui ont déjà été confrontés à la police me le disent : « Heureusement que je n'étais pas noir ». Les Noirs avaient « accepté » Trump car beaucoup se sont senti « libérés » par le grand nombre d'emplois créés. Mais après le Covid-19, cela ne marche plus. Les Blancs savent, eux, qu'ils ont le pouvoir d'arrêter cette spirale. Tout va dépendre de l'ampleur et de la durée des mobilisations. Avec le ras-le bol général lié à un mouvement anti-Trump, c'est devenu la clé de l'avenir du pays.
Bien sûr en France, c'est une situation très semblable, même si on est dans le déni. On savait tout sur les violences policières depuis Malik Oussekine, mais on s'en fichait. Dans les médias, c'est un sujet très sensible. Le parallèle énerve mes confrères éditorialistes. Evidemment, ce ne sont pas la même histoire, la même organisation, la même proportion. Mais c'est la même chose : les policiers contrôlent à tour de bras dans les « quartiers » où vivent les jeunes issus des émigrations maghrébines et africaines, en agissant en toute impunité. Je leur dis : « Vous cherchez les différences pour ne pas voir les similitudes et vous ne pouvez que tomber sur les ressemblances ». Ressemblances y compris sur la reconnaissance politique, sociale et salariale des policiers. Pensons à la différence d'avec un pays comme l'Irlande, où la police, non armée, est très appréciée de la population.
Vous sentez-vous emblématique des valeurs de l'Union-ALFM ?
D'abord, partout où je vais, quand je rencontre quelqu'un qui a fait un lycée français à l'étranger, j'ai immédiatement des codes partagés avec cette personne. J'ai l'impression troublante qu'on a fait la même école, même si elle ne vient pas des Etats-Unis. Cela peut être Londres, Tokyo, Budapest, ou Casablanca (lycée de Casablanca), on a eu une expérience similaire, on est passé par un sas commun. Avoir été dans un lycée français de l'étranger nous a donné une approche mentale multiple pour affronter un problème. Comme l'établissement français n'est pas en symbiose avec son milieu, une sorte d'isolat, on a tous expérimenté cette double vision, le vécu à l'intérieur de l'école et celui à l'extérieur de l'école. Et de ce fait, on s'est habitué à voir les choses de deux façons et avec deux systèmes de référence. En français, les références sont la décolonisation, la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, l'affaire Dreyfus, la Commune, Napoléon III, Napoléon, le Révolution française, les guerres de Religion, la guerre de Cent ans.... En anglais-américain, vous avez tout à fait autre chose : l'Irak, le Vietnam, la guerre de sécession, la révolution américaine, l'esclavage. Or cette approche multi-perspective est primordiale dans notre monde globalisé. Dans un lycée français, on a cet apport automatiquement. C'est une particularité française, parce que la France, c'est une espèce de « patrie intellectuelle » en plus d'être une « patrie physique ». En plus d'être un vrai pays terrestre, géographique, solide, c'est une espèce de civilisation dématérialisée. Et ces deux notions coexistent à très haut niveau à cause de l'Histoire. Dans le monde entier, chacun sait ce que c'est que la France et ses valeurs. Par exemple, au Turkménistan, tout le monde sait ce que c'est que la France, mais en France, on ne sait pas ce que c'est que le Turkménistan ! Ils ont peut-être eu de fabuleux personnages dans le passé, mais ils ne se sont pas imposés sur la scène intellectuelle mondiale, donc on ne peut pas s'y référer ! C'est un phénomène ancien que d'avoir une espèce de diglossie intellectualisante. Et sans pour autant rapetisser la culture américaine, pour preuve la littérature américaine actuelle est plus vivante que la française, en production, en quantité et en notoriété. Mais, en matière d'éducation, il n'existe pas dans le monde entier un réseau d'enseignement aussi vaste et unifié, qui accueillent non seulement des Français expatriés, mais beaucoup d'élèves venus d'autres horizons. Tant que la Chine n'a pas encore ouvert de lycée aussi universaliste à l'étranger, ni la Russie, nous existerons encore ! Ce sont ces raisons historiques objectives qui font que la langue française est ce qu'elle est. Et moi, j'ai eu l'honneur de naître dedans.
Paris, le 9 juin 2020
Interview réalisée par Yousra Laqbaqbi et rédigée par Effy Tselikas

 6
6












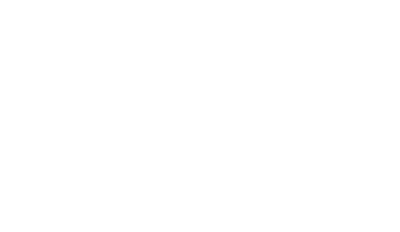
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.